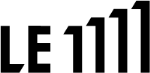Article parut sur le blog de follow art with us, le 19 mars 2014 par Béatrice Cotte
Cette semaine je laisse la plume à mon amie Céline Moine, pour un récit de voyage sensible et touchant. Galeriste investie, elle est partie en Inde en décembre dernier suivre la création artistique de Thomas Henriot, artiste qu’elle défend. Durant son séjour à Bénarès, elle a rédigé un petit journal de bord, somme de sensations, d’impressions et de souvenirs d’un voyage marquant. Un récit intime qu’elle a bien voulu partager avec nous. Une belle occasion de découvrir le travail de Thomas Henriot autrement, doublée d’un formidable témoignage d’amitié, pour lequel je la remercie tout spécialement !
9 décembre 2013
L’arrivée à Bénarès est un grand bonheur après la nuit passée dans le train, tête-bêche sur la même couchette avec Thomas. Gare modeste par rapport à Delhi. Peu de monde. Nous en profitons pour acheter nos prochains billets : lui pour Delhi, moi pour Calcutta le 13 décembre. Rickshaw vélo pour rejoindre notre camp de base, chez Kedar, un indien qui loue quelques chambres entre 150 et 200 roupies (environ 2€) la nuit. C’est la maison de Thomas à Bénarès. Il y vient depuis des années, y a déjà séjourné plusieurs mois d’affilée. Les chambres ne sont pas retenues. A notre arrivée sans préavis, Kedar, heureux, l’accueille et le conduit droit à sa chambre habituelle, assez vaste, avec le confort minimum d’un grand lit dur comme le bois, d’un ventilateur bruyant et d’une lumière électrique.Nous ne prenons pas le temps de nous laver malgré la nuit dans le train. Ascension de la maison de Kedar. Son toit-terrasse est une première immersion par le haut dans la vie de Bénarès. Les singes y courent partout, les enfants et les jeunes hommes se livrent à des joutes extraordinaires de cerfs volants, les femmes y font sécher le linge, un jeune indien tente de nous séduire de ses poses alanguies avant d’être rappelé à l’ordre par sa mère. J’aime les couleurs douces et décrépies, la lumière caressante, le calme et la simplicité qui règnent chez Kedar. Nous sommes installés au-dessus de la famille.
Première sortie de chez Kedar. Ruelles étroites, jonchées de détritus comme partout ici. Les intouchables les ramassent. Thomas est comme chez lui, se repère sans la moindre hésitation dans ce dédale pour rejoindre la rue principale, nous fraye un chemin entre les vaches et les chiens.Sur les 100 premiers mètres, il sera hélé plusieurs fois : « Thomas ! », « Painter babu ! ». Les gens sont heureux de le revoir. Nous buvons plusieurs chaï sur la route puis nous arrêtons dans une cantine uniquement fréquentée par les indiens pour déguster un Palak Paneer – des épinards au fromage – son plat favori lorsqu’il est ici. Il jubile de retrouver ses repères, le même plat me rendra malade.Direction le Ghat principal. Avant même de pouvoir descendre les quelques marches qui conduisent au bord du Gange, plusieurs amis indiens viennent encore le saluer. Autre chaï en haut des marches, assis face au Gange, en compagnie des brahmans, sadous, chèvres, vaches, chiens. Quelques touristes aussi, repérables de loin non seulement par leur look, mais aussi par leur rythme et leur manque de fluidité dans l’espace.
Je suis impressionnée de faire face pour la première fois à ce fleuve sacré parmi tous, écoutant Thomas parler hindi, me délectant de mon chaï. Impressionnée aussi par cette lumière si particulière, une lumière douce et brumeuse, qui embrasse tout dans un bain irréel, trompe les distances et les échelles, fait irradier les couleurs – orange et fushia typiques de Bénarès – avec une intensité folle.Premiers pas sur les rives pavées du Gange. Promenade toute en ruptures. On sent bien que rien n’est stable ici. Outre les gestes immuables des libations, tout est mouvement et stratifications permanentes. Une beauté de friches, ou le plus raffiné s’arrange avec le détritus.La rive du Gange est une salle de bain géante. Je n’avais jamais vu personne se savonner, shampouiner, ni se brosser les dents avec tant d’application.
10 décembre
Ca frotte, ça brasse, ça plonge, ça rame, ça crache, ça éructe, ça prie, ça s’étend, s’endort, s’alanguit, ça crache encore, ça assouplit, ça mange, ça chaï, ça discute, ça chillum, ça caresse les vaches, latte les chiens, nourrit les pigeons, ça jette, ça chie, ça encense, coupe le bois, ça pleure au bucher, ça crie parfois, ça brûle les corps sous leurs sublimes apparats multicolores et scintillants, ça pleut des cendres, ça joue du cerf volant, ça palabre, ça tend le moignon, ça baille, ça prend le soleil, ça se déploie en souplesse comme si le temps avait tout son temps.Et puis les chiens presque morts, qui semblent se décomposer sur place et ces centaines de chiots plus sales et attendrissants les uns que les autres. Les animaux sont partout, autant que les gens. Certains vont bien, d’autres sont fous. Autant que les gens. Certains ont choisi leur folie, celle d’un chemin spirituel absolu coupé de tout le reste, d’autres que l’on pourrait croire en pleine contemplation ou méditation sont soudain assaillis de tressaillements incontrôlables.Ça chante, ça écoute la musique sur le téléphone portable, ça vient se signer le front à l’eau du Gange entre copines de 15 ans.Et cette boue multicolore qui constitue la rive du Gange, fange séduisante ou se mélange les fleurs en quantité, déchets divers, cerfs volants échoués, cadavre gorgé d’eau de chèvre ou de vache.Ça vient discuter. Nous inciter à faire attention à l’esprit qui est un singe. Il faut se méfier de l’esprit me dit-on, penser avec le cœur et l’âme pour accueillir les choses naturelles. Ne pas chercher à retenir, surtout en amour. On m’illustre le propos : si on retient l’eau au creux de ses mains, ne finit-elle pas par croupir ? Mais si on laisse couler selon ses désirs, l’eau rejoint l’océan, l’immensité de tous les possibles. Et me revient cette phrase de Thomas d’Aquin « Aime donc et fais ce que tu veux ». Le lâcher prise revient souvent dans les discussions et chez les masseurs qui invitent à lâcher « loose ! loose ! ».
A côté, Thomas dessine depuis 5h sans discontinuité. Il s’attaque à un gros morceau sur le Ganesh Ghat. Un édifice rouge, ancien, une forteresse baroque, palais admirablement défraichi, relai bienvenu pour les nuées de pigeons et les fils électriques avec lesquels on s’arrange comme on peut ici. Comment fait-il pour tenir des heures sur le pavé, penché sur son papier ? Aussi souple que lui, il compose avec ses jambes fines, change parfois de position, adopte des attitudes de danseurs au repos. On lui pose souvent des questions. Souvent les mêmes. Il répond succinctement en hindi sans quitter des yeux le dessin en cours.Tout est exagéré, exacerbé à Bénarès ou la vie, la mort, la maladie, la spiritualité, la trivialité, la grandeur et la décadence s’accommodent les uns des autres.
Thomas aussi exagère. Il distord les formes, les sensualise, transforme le décrépi des murs en dentelle reluisante, injecte une lumière particulière aux façades, se les réserve au noir. Il exacerbe les extravagances du monument non encore déchu. Son dessin est baroque, comme l’est Bénarès. Barrocco, une perle irrégulière, un monstre baroque, amplifié, mis en abyme.Il est 17h. La lumière tombe. Une autre population arrive sur les rives du Gange. Toujours les enfants qui se livrent à leurs joutes aériennes de papier et les jeunes hommes, dont certains fument leur joint face au Gange, qui absorbe tout.
11 décembre
Près de 4h pour rejoindre Thomas sur le Ganesh Ghat aujourd’hui, happée par les gens, le dédale interminable des ruelles, les discussions à proximité des bûchers, le rythme lent de la barque sur le Gange.A déambuler seule, je suis une proie providentielle pour les jeunes hommes dont l’activité principale est de séduire les touristes, en leur proposant le chillum pour les détendre un peu si nécessaire. Les jeunes indiens sont polyglottes pour mieux capter la demande potentielle : anglais minimum, japonais, coréen, allemand etc.Chaï au bûcher. Retour sur les rives. Ça rase la tête de quelques enfants, ça épouille les autres, ça enfile des perles, ramasse les fleurs décomposées, ça lave les buffles à l’eau du Gange, ça s’endort aussi profondément que les chiens.
Et ça regarde Thomas travailler. Thomas qui change comme son dessin. Je les trouve tous deux métamorphosés en quelques heures. Lui a changé de couleur – rougi par le soleil – et de regard, du khôl plein les yeux.Le dessin s’étend et se renforce. Chaque tache d’encre est un exercice d’absorption et de transmission. Leurs contours dentelés et leurs dégoulinures constituent autant de symptômes du temps lentement imprégnés sur les façades.25 indiens, la plupart installés sur les marches depuis des lustres, observent avec attention le dessin en train de se faire. Certains ne détachent pas une seconde leur regard de la feuille, suivant le moindre mouvement du pinceau. D’autres naviguent entre le trait et le visage de Thomas. D’autres encore voudraient entrer dans ses yeux pour participer au dialogue intime et silencieux qui se joue : Thomas lève les yeux, ils le regardent regarder, Thomas replonge dans le trait, ils se noient avec lui.La première étape du premier rouleau est achevée. Arrive l’empreinte du sol. Grand pinceau, beaucoup d’encre, beaucoup d’eau pour frotter le pavement , imprégner le papier du lieu : j’y suis, ici et maintenant.
Le dessin, subtil et délicat, y compris dans ses aberrations, subit une ultime transformation : le grand pinceau s’attache à la façade, révèle ses béances, soutient quelques éléments, en fait disparaître d’autres. Mais l’encre de chine à quelque chose de malin. Les traits qui semblent voués à s’éteindre sous l’effet de cet ultime exercice gestuel renaissent peu à peu par transparence. Le passé ressurgit, suinte à la surface et le dessin achève ici son travail de stratifications.Un ultime passage pourtant. Celui du rose fushia dans le ciel de Bénarès, celui-là même qui embrase l’espace à certaines heures et les tissus toujours. Le rose et le noir fusent, traversent la blancheur du papier japon, dansent avec les oiseaux et les cerfs volants. Thomas se lève, fume une cigarette, entame des allers-retours visuels entre le palais et le dessin du palais, prend de la distance pour donner les dernières touches. Un indien applaudit.
12 décembre
J’ai du mal à quitter ma chambre tant je suis subjuguée par la beauté de ses murs défraichis et toute cette saleté ! La lumière si envoutante et caressante me tiendrait ici des journées entières. J’ai faim. Je sors. Plaisir de retrouver les ruelles, les gens, les vaches.Je m’arrête dans une cantine, commande des œufs Kafta, un chapati et du riz baignant dans le lait, parsemé de raisins secs et de noix de cajou. Tout est délicieux. Chaque bouchée de Kafta est un petit électrochoc pour le palais que j’apaise avec la douceur du riz. Après le repas, j’irai boire mon chaï sur le pas de la porte voisine. Les gens sont charmants et souvent protecteurs avec moi grâce à Thomas qui m’a présenté comme sa sœur. Je demande un chaï, 5 roupies. On me prie de m’asseoir sur une chaise posée dans la ruelle au soleil. C’est la seule chaise à l’horizon. Je bois le nectar sucré par petites gorgées tout en fumant une cigarette. En face, on agite à tout va les cloches du temple. Le son envoûtant couvre presque l’agitation de la rue.Après 4h à déambuler dans les ruelles, boire des chaï avec les commerçants, négocier des bijoux, du masala, de l’huile d’amande douce, de l’encens et des pigments de couleurs, je me dirige enfin vers le Ghat principal pour retrouver Thomas. C’est le troisième jour qu’on me voit faire le même chemin. Beaucoup me reconnaissent. On me propose de l’herbe, puis de partager des gâteaux. Enormément d’animation autour des buchers aujourd’hui.Il est plus de 17h, le Gange coule ses trainées roses. C’est sublime. Si apaisant après le tumulte de l’après-midi. Je croise un nième chiot qui mâchonne avec allant un morceau de bois. Sa mère est proche. Je remarque que les tripes du chiot se répandent sur le pavé. Il n’a pas l’air de souffrir. C’est toute la folie de Bénarès ou la beauté et l’innocence côtoient toujours le vil et le morbide.Je constate que ce chiot éventré ne m’émeut pas plus que les rangées de lépreux aux corps rongés, aux membres amputés, que ce vieillard croisé tout à l’heure trainant son corps dans la poussière à la force des bras, que ces corps douloureusement déformés, monstrueux, que l’on croise sur les rives du Gange. Bénarès change définitivement la perception des choses. Ces mêmes visions m’auraient traumatisées en France. Ici, elles font partie du flux.
13 décembre
Dernières heures à Bénarès. Réveil à 6h dans l’impatience de découvrir les premières lueurs du soleil sur le Gange. Nous partons avec Thomas. Deux chaï. Puis, deux autres chaï. Le Gange est incandescent…
Céline Moine