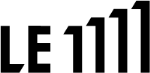Par Marc Soléranski. HUGUES ALLAMARGOT x DIEGO VELASQUEZ
LE TEMPS D’UN ESPACE
HUGUES ALLAMARGOT x DIEGO VELASQUEZ
L’univers d’Hugues Allamargot qui manie le dessin, la sculpture, les installations audiovisuelles, les performances, paraît fort éloigné du siècle d’or espagnol. Pourtant, un célèbre tableau de Vélasquez hante son imagination depuis plus de trente ans : Les Ménines.
Comment cette scène de cour peinte en 1656 peut-elle inspirer un artiste préoccupé par les questions sociales, politiques et écologiques du XXIe siècle ? Que peut-on trouver de commun entre ces courtisans enrubannés, ces demoiselles engoncées dans leur robe à vertugadin, et la génération d’Internet ?
Diego Vélasquez, né à Séville en 1599, grandit dans une ville à la croisée des grands axes commerciaux, enrichie par les colonies récemment conquises au nom des tout puissants souverains d’Espagne. Pourtant, cette société prospère est secouée par une crise intellectuelle sans précédent : « l’âge du doute ». En faisant découvrir aux Européens des horizons qui leur étaient inconnus, les explorateurs du Nouveau Monde et les circumnavigateurs placent les autorités du savoir occidental en face de leur ignorance : à quelles sources grecques, romaines, juives, chrétiennes ou arabes se référer pour étudier ces peuples lointains, ces climats, ces végétaux ou ces animaux mentionnés dans aucun ouvrage ? L’éducation fondée sur les textes spirituels paraît impuissante à donner des réponses concrètes.
Depuis le XVIe siècle, les doctrines protestantes s’opposent à l’enseignement de l’église apostolique et romaine qui a régné dans l’Europe médiévale. C’est à la frontière entre les Pays-Bas catholiques et les régions converties à la Réforme que naît en 1558 le grand peintre et dessinateur Hendrik Goltzius : sa série de gravures consacrées aux Jours de la Création illustre La Genèse d’une manière paradoxale. Au premier jour (création de la lumière) , il oppose un dieu solaire à une déesse nocturne séparés par un ange. Au quatrième jour (répartition de la Terre, de la Lune et des étoiles) c’est un Apollon, conducteur du char solaire chez les Romains, et une Diane, déesse de la chasse et de la nuit, qui incarnent les astres. Goltzius faisant fi des clivages entre la Bible et les mythologies polythéistes, cherche à réconcilier la culture judéo-chrétienne avec l’héritage païen antique, en se faisant l’écho des contradictions de son époque.
Comme un coup de grâce aux certitudes du temps jadis, l’ouvrage testament de Copernic soutient contre les théories géocentriques que notre monde est une planète qui tourne autour du Soleil. Si la terre que nous croyons stable sous nos pieds est en mouvement, si l’astre solaire que nous voyons se déplacer dans le ciel d’Est en Ouest est fixe, qu’est-il permis de croire sans être dupes de nos sens ? À l’instar des questionnements de Montaigne, des illusions dramaturgiques magnifiées par Shakespeare ou des hallucinations du Don Quichotte de Cervantès, la mode est au scepticisme dans tous les domaines de la pensée. Ainsi, les artistes abandonnent les canons de Vitruve chers à Léonard de Vinci, pour cultiver des chimères. L’histoire de l’art désigne sous le nom de Maniérisme ce style qui, des années 1530 jusqu’à l’aube du XVIIe siècle, malmène les idéaux de la Renaissance : du Jugement dernier de Michel-Ange aux monstres infernaux de Brueghel l’ancien, des natures mortes d’Arcimboldo formant des visages humains jusqu’aux corps disproportionnés du Greco, le Maniérisme reflète les interrogations d’intellectuels européens qui ne maîtrisent plus les lois de la nature.
Mais, les autorités ecclésiastiques se doivent de freiner ce scepticisme : remettre en question des affirmations validées par l’enseignement religieux, n’est-ce pas ôter toute crédibilité au pouvoir de l’église et fournir de nouveaux adeptes aux religions réformées? Douter de tout ne mène-t-il pas nécessairement à douter de la foi voire de l’existence de Dieu ? En 1600, un an après la naissance de Vélasquez, Giordano Bruno est brûlé vif à Rome. Ce philosophe condamné pour blasphème, a défendu la thèse d’un système solaire qui aurait d’innombrables équivalents dans un univers infini. Seize ans plus tard, les théories de Copernic sont mises à l’index et en 1633, le savant Galilée, menacé du même sort que Giordano Bruno, abjure sa doctrine devant le Saint Office. L’année suivante, 1634, Rembrandt publie une exceptionnelle Annonce aux Bergers rompant avec les représentations traditionnelles du sujet. Contrairement à l’iconographie des cathédrales gothiques, où des anges rassurants apportent la Bonne Nouvelle à des bergers éblouis par la lumière divine, le maître hollandais nous livre une vision apocalyptique : lecteur de la Bible suivant l’enseignement protestant, Rembrandt illustre le passage de l’Evangile selon Saint Luc où les gardiens de troupeaux sont « saisis d’une grande crainte » avant les paroles de l’ange qui annonce la naissance du Sauveur. L’armée des Cieux apparaît dans une clarté rayonnante combattant l’obscurité du paysage. Au registre inférieur, parmi les arbres tourmentés, les pâtres courent dans le plus grand désordre comme leurs bêtes effrayées. La lumière céleste n’attire plus, elle fait fuir. En pleine révolution copernico-galiléenne, Rembrandt met en scène la faiblesse de l’humain face à l’inconnu et la terreur qu’inspire un ciel dont il ne parvient plus à percer les secrets.
À peu d’années de différence, la carrière de Diego Velasquez est contemporaine des peintures de Rembrandt. Plus monumentale, son œuvre se nourrit des compositions théâtrales caractéristiques de l’art baroque : chaque tableau semble être un cadre scénique où évoluent des figures à échelle naturelle, animées de gestes amples. A l’idéologie du doute, il emprunte les effets de miroirs et les « images dans l’image » qui brouillent les repères entre la réalité et l’illusion. Ces procédés se retrouvent chez bien d’autres artistes de l’Europe baroque, de la Méditerranée à la mer du Nord, mais ce qui place Les Ménines en dehors de toute tradition est la répartition des protagonistes dans l’espace pictural : au centre de la composition, l’Infante Marguerite – fille du roi d’Espagne Philippe IV – est sollicitée par ses demoiselles d’honneur – les « ménines » à l’origine du titre – et divertie par une naine et un bouffon jouant avec un chien.
Trois autres membres de la cour royale (aux identités controversées) occupent l’arrière-plan. À gauche, Vélasquez en autoportrait peint une grande toile dont nous ne voyons que le châssis. Au-dessus de l’infante, un miroir reflète les portraits évanescents du roi et de la reine. Une première interprétation, répandue dans les livres d’Histoire, suggère que ce tableau représente les divertissements destinés à faire patienter la petite princesse pendant que ses parents posent dans l’atelier de leur portraitiste. Chaque spectateur du tableau exposé au musée du Prado, occuperait ainsi la place logique du couple royal visible dans le miroir. Une autre hypothèse plus troublante provient d’une description d’Antonio Palomino (1724) qu’accréditent les reconstitutions en trois dimensions de la salle où se situe la scène des Ménines : la position du miroir par rapport au châssis de gauche et au regard de l’autoportrait ne refléterait pas le roi et la reine en personne mais un détail du tableau que réalise le peintre (ce qui expliquerait l’imprécision de son dessin). Si cette théorie se vérifiait, Vélasquez pousserait alors à l’extrême l’illusion baroque, puisque le détail du miroir irait au-delà de « l’image dans l’image » : ce serait la représentation du reflet d’une représentation de la réalité ! Quant au sujet que traite l’artiste à la palette dans le tableau invisible tourné vers lui, ce ne serait plus ni Philippe IV et son épouse, ni l’infante et son entourage, mais nous-même ou notre monde qu’il prendrait comme modèle. Pour la première fois dans l’histoire des portraits de cour, un peintre ose se représenter plus grand que les souverains dont il est le vassal et place au premier plan d’une scène protocolaire les coulisses du pouvoir en magnifiant l’enfance, la domesticité et les êtres difformes que la société met au rebut. A l’inversion du mouvement des planètes, répond le renversement de l’ordre social : si la Terre n’est plus au centre de l’univers, les têtes couronnées ne sont plus au sommet de la hiérarchie. Désormais, c’est aux artistes et aux marginaux de redéfinir le Monde.
Malgré ces échanges déroutants entre l’illusion et la réalité, il reste difficile de classer Les Ménines dans le pur style baroque. Vélasquez préfigure par la construction linéaire de l’espace pictural et l’équilibre de sa composition, le retour à l’ordre qui succède à la philosophie du doute. Bien qu’il décède en 1660, quatre ans seulement après l’achèvement des Ménines, son oeuvre est aujourd’hui considérée comme une transition du baroque vers le classicisme de la seconde moitié du XVIIe siècle : après la reconnaissance du système solaire par plusieurs écoles européennes, l’héritage de Descartes, Pascal et Newton, inaugure l’ère des sciences positives où le raisonnement mathématique devient la base de toute discipline permettant de comprendre et de transformer la nature. La rigueur géométrique s’impose même dans la création artistique. Au fil des révolutions, le rôle de la spiritualité dans la pensée occidentale se réduit au profit d’une éducation fondée sur le progrès scientifique et technique. Quel bilan pouvons-nous en tirer aujourd’hui ? Telle est la question que pose Hugues Allamargot, à travers une scénographie inspirée par l’atelier représenté dans Les Ménines…
Soucieux de concilier la recherche scientifique avec les arts plastiques, Hugues Allamargot réalise des installations illustrant le rapport entre l’espace et le temps. Dans le tableau de Vélasquez, la trajectoire de la lumière venant de l’extérieur, la surface réfléchissante du miroir, la surface cachée du tableau retourné, la porte ouverte vers le vide, les tableaux accrochés au registre supérieur, forment un réseau complexe de mondes réels et imaginaires dont les limites ne sont pas toujours définies. Transposant cet enchevêtrement de sphères spatio-temporelles dans le monde d’aujourd’hui, Hugues Allamargot reprend la composition des Ménines dans son installation. Ainsi, de gauche à droite, se succèdent : un écran où se projette l’artiste se reflétant dans l’eau courante, une vidéo du couple dirigeant la galerie LE 1111, les gravures des maîtres du passé ainsi que les tableaux de Picasso, et l’enseigne lumineuse de La Suite de Fibonacci. Par leur disposition, ces éléments correspondent respectivement à l’autoportrait de Velasquez tenant la palette, au couple royal dans le cadre du fond, aux tableaux suspendus au mur et à la lumière venant de la droite. Une plaque froissée qui ne peut être vue depuis l’entrée, mais qui se dévoile sur le côté gauche lorsque le visiteur revient sur ses pas, fait écho à la toile cachée que peint l’auteur des Ménines. Ce Trou noir dont le titre se réfère à un objet optiquement invisible en astronomie, est à la fois sombre et lumineux, opaque et réfléchissant ; comme le chassis retourné, il freine notre champ de vision tout en libérant notre imagination. Placé à côté de la série des Molécules, il met en parallèle l’infiniment grand et l’infiniment petit, donnant à l’exposition sa dimension cosmologique. Au XVIIe siècle, aucun instrument ne pourrait permettre des observations aussi poussées que les découvertes des astrophysiciens et des biologistes d’aujourd’hui, mais l’art de Vélasquez comme la lunette de Galilée franchit déjà les limites du visible pour ouvrir les portes d’un monde infini. Ce n’est plus une simple scène intérieure, mais une mise en abîme, un microcosme qui porte en germe l’univers.
Pareil au regard de l’autoportrait de Velasquez qui fait entrer malgré eux les visiteurs du Prado dans l’espace des Ménines, l’installation est une œuvre interactive à laquelle participe chaque spectateur, contribuant à lui faire perdre le sens de la réalité. Quelles sont les conséquences du fascinant chemin parcouru en moins d’un demi-siècle depuis les caméras super 8 rendant des films de qualité aléatoire au multimédia du XXIe siècle mettant les images de synthèse à la portée du plus grand nombre ? Une amélioration de la condition humaine ou le risque de ne plus distinguer la vie réelle du monde virtuel ? Le progrès a-t-il son revers comme les disciples de Copernic qui, en progressant dans la connaissance de l’univers ont provoqué le doute et l’intolérance ?
Opposant sa méthode rationnelle au scepticisme de l’époque baroque, Descartes encourage l’homme à se rendre « maître et possesseur de la nature ». Le nombre d’or qui trouve son application dans les formes régulières de certains végétaux et mollusques, peut être interprété comme l’expression mathématique de l’équilibre universel opposé au « chaos ». Pourtant, la volonté de dominer par le calcul l’environnement naturel comme la société humaine, ne mène-t-elle pas au résultat contraire ? La Suite de Fibonacci qui éclaire la pièce projette ainsi sa part d’ombre. Message à double tranchant, cette spirale traduit également les réflexions écologiques d’Hugues Allamargot : « c’est l’harmonie naturelle que l’humain doit respecter. La nature est comme notre ombre, elle nous suit partout mais nous avons souvent tendance à l’oublier » commente l’artiste.
Depuis l’an 2000, l’être humain fait-il un bon usage de la science ? Au sortir de deux années de crise sanitaire, où les autorités des cinq continents ont contrôlé les libertés individuelles en s’appuyant sur un discours scientifique, face au réchauffement climatique et aux catastrophes naturelles, à la veille d’élections présidentielles où le peuple ne se reconnaît plus dans ses dirigeants… Ne vivons-nous pas une perte de repères semblables aux contemporains de Vélasquez ? Le progrès scientifique nous libérera-t-il de nos angoisses face à l’avenir ou nous fera-t-il basculer dans un nouvel obscurantisme ?
Au premier plan, occupant la place de l’infante Marguerite, une sculpture de béton et de verre – La Fontaine de Jouvence – est entourée de deux bustes jouant le rôle des suivantes. Hugues Allamargot comme Velasquez met un enfant au centre de la scène, mais s’agit-il de la princesse des Ménines ? Le corps asexué se pare d’une chevelure et d’une robe lorsque l’eau de la fontaine s’écoule. Sitôt que le flot s’arrête, sa forme devient celle d’un garçon ; et l’artiste d’expliquer : « Je veux réfléchir sur la condition de l’enfance dans le monde d’aujourd’hui, et sur les débats autour de l’identité sexuelle auxquels sont confrontés les adolescents à notre époque ». L’héritière de Philippe IV semble ne rien avoir en commun avec les jeunes filles du XXIe siècle, pourtant sa gravité nous interroge. Cette princesse vivant dans une opulence à laquelle ne peut accéder qu’une infime minorité de la population espagnole, ne représente pas la joie de vivre. Obligée de porter des tenues d’apparat inadaptée à sa croissance, élevée dès le berceau dans un protocole rigide, elle n’est plus une fillette épanouie dans les divertissements de son âge mais une souveraine en puissance, posant dans l’attitude sévère de ses aînés. Sa position privilégiée la rapproche paradoxalement des enfants martyrs nés dans les pays déchirés par les guerres civiles: projetés trop tôt dans le monde des adultes. Grandissant dans des palais coupés du reste du monde, sollicitée quotidiennement par les flatteries des courtisans, l’infante Marguerite ne peut soupçonner que ses portraits seront malmenés quatre siècles plus tard, par un de ses plus célèbres compatriotes : Pablo Picasso.
Entre 1956 et 1957, pour les 400 ans du chef-d’œuvre de Velasquez, le peintre autrefois décrié pour Les Demoiselles d’Avignon réalise quarante-cinq variantes de Las Meninas léguées au musée de Barcelone. Entrant dans la dernière période de sa création, Picasso décline jusqu’à la fin de sa vie ces personnages échappés de la cour de Philippe IV dans des Portraits imaginaires où les modèles déstructurés de Velasquez ne sont plus reconnaissables que par une collerette blanche, une moustache à la mousquetaire ou une épée de gentilhomme. A l’opposé des techniques picturales du XVIIe siècle, ces tableaux sont brossés de couleurs vives sans observation naturaliste ni recours aux règles de la perspective. Certains y voient une provocation iconoclaste, d’autres un émouvant hommage au maître de la peinture baroque comme précurseur des avant-gardes du XXe siècle. Pourtant, Picasso ne revendique pas un engagement intellectuel et justifie ainsi sa démarche : « à douze ans, je dessinais comme Raphaël. Il m’a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant ». Fils d’un professeur à l’école des Beaux-Arts, Pablo est un génie précoce qui apprend à reproduire les modèles classiques dès son plus jeune âge. En 1946, visitant une exposition de travaux d’écoliers, il prend conscience que son père ne l’a jamais laissé exprimer librement son imagination, guidant ses premiers dessins selon les règles académiques. Comme la figure centrale des Ménines, Picasso a été privé d’enfance. Nommé à la tête du Prado par les républicains espagnols, il ne peut retourner dans son pays natal suite aux horreurs de la Guerre civile et à la victoire de Franco. Expatrié, peignant en Provence loin du prestigieux musée de Madrid, le peintre, devenu plus qu’octogénaire, pourrait nous livrer la vision d’un vieillard désabusé, mais lui préfère la candeur d’un regard d’enfant pour dialoguer avec l’âge d’or de la peinture espagnole. Lorsqu’il dresse le bilan de sa longue vie et des épreuves qu’il a traversées dans un monde corrompu par les guerres mondiales et les dictatures, Picasso rejoint les philosophes qui voient dans le retour à l’innocence originelle le salut de l’humanité.
Répondre par la liberté du langage artistique aux interrogations d’un monde en crise, n’est-ce pas en définitive le lien qui unit Hugues Allamargot aux maîtres du passé ? Goltzius tentant de réconcilier la culture biblique et la culture païenne par ses illustrations de La Genèse en pleine guerre entre Catholiques et Protestants,… Vélasquez et Rembrandt brouillant les repères entre l’illusion et la réalité au cœur d’un XVIIe siècle où les fondateurs de la science moderne luttent contre le scepticisme et l’intolérance ecclésiastique,… Picasso à la recherche d’un paradis perdu, dialoguant avec les symboles d’une culture tombée aux mains de ses ennemis… Autant de personnalités écartelées entre deux mondes, vivant sur une faille sismique d’où peut sortir une éruption destructrice comme la source d’une création nouvelle. C’est peut-être ce qui les rapproche de nous. N’est-ce pas un nouvel entre-deux, équilibre fragile entre le progrès et la barbarie, que vit l’être humain du XXIe siècle ? Quand l’étude physique de l’univers ne suffit plus à guérir la société de ses doutes, quand les innovations techniques sont détournées par la course au profit et à la surconsommation, quel sera l’avenir de notre monde? L’œuvre d’Hugues Allamargot soumet ces questions à la subjectivité du public sans revendiquer des réponses péremptoires. Au savant qui veut expliquer l’univers, il oppose le discours de l’artiste qui peut le recréer.
Ainsi, comme ces étoiles éteintes dont la clarté franchit les milliers d’années lumière qui les séparent de la Terre, le message du vieux maître des Ménines traverse les frontières et les siècles pour dialoguer avec l’art contemporain. Hugues Allamargot prouve ainsi que, comme l’étude de l’univers, le travail de l’artiste redéfinit les rapports de l’espace et du temps.
Marc Soléranski
Historien d’art et dramaturge, 16/03/2022